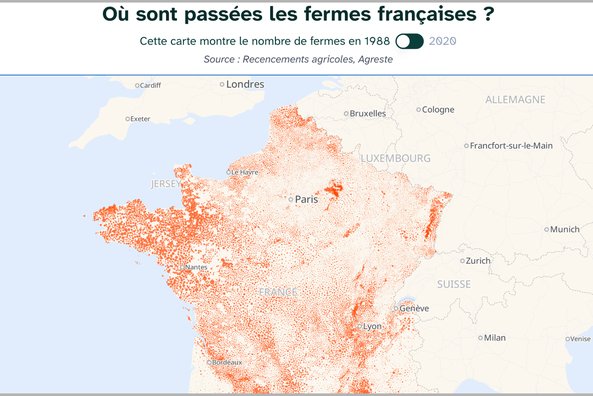Affiche du film
Un an après la sortie du documentaire Transmettre, qui documente de manière intime la difficile question de la transmission agricole, Jérôme Zindy (co-auteur et réalisateur) et Marie Balthazard (co-auteure et coordinatrice chez Terre de Liens Alsace) reviennent sur l'écriture de ce film si particulier, mis à l'honneur lors du prochain festival Alimenterre.
Cette interview a été menée et retranscrite par Charlotte Giorgi le 3 octobre 2025.
Le synopsis du film
Au cœur d’une vallée vosgienne d’Alsace, la ferme du Runtzenbach incarne un modèle d’agriculture paysanne, biologique et citoyenne. Ce refuge face au monde consumériste est l'œuvre de Monique et Francis Schirck. Elle leur aura apporté, mais aussi beaucoup pris, parfois jusqu’au plus profond de leur chair. De cette vie de labeur, un équilibre, fragile, est enfin trouvé. Mais Francis a 67 ans : l’heure de la retraite a sonné. Il faut donc “transmettre” pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Leur fille unique ne sera pas agricultrice. Alors, à qui “transmettre” ? Comment s’assurer que le combat d’une vie perdure ?
Du désarroi des agriculteurs face au modèle classique de transmission jusqu’à la mise en perspective d’un avenir possible, le documentaire de 52min s'est donné pour mission de suivre et documenter sur plusieurs mois et de l’intérieur l’évolution de la question complexe de la transmission, une histoire singulière et universelle à la fois. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain, et avec lui, notre vision du monde.
Marie ma première question porte sur ton parcours à Terre de Liens. Mais aussi le parcours des deux agriculteurs, Francis et Monique, qu'on suit dans le film et qui ont participé à la création de Terre de Liens Alsace. Est ce que tu peux nous raconter ?
MARIE : Oui. Moi, je suis arrivée à Terre de Liens Alsace en 2011, à l'époque où le réseau Terre de Liens était encore tout petit. On était une trentaine de salariés sur toute la France. Le réseau était vraiment en train d'émerger, de se développer. Et en Alsace, ce qui a conduit à la naissance de l'association, c'était un constat fait à la fin des années 2000, qu'on avait toute une génération de pionniers de l'agriculture bio, biodynamique, qui risquait de disparaître parce qu'ils n'avaient pas de successeurs. Et l'idée a été de créer l'association Terre de Liens Alsace pour essayer de répondre à cette problématique dans un contexte où on est une petite région agricole avec beaucoup de pression sur le foncier. Et on a été un peu précurseurs sur ce sujet parce que c'était une époque où on ne parlait pas du tout de transmissions, et on avait ce groupe d'une quinzaine de paysans et paysannes qui commençait à s'inquiéter de la suite. C’était très empirique. Et donc moi j'ai été embauchée sans y connaître grand-chose, pour aller rencontrer toutes ces fermes. Et sur la ferme du Runtzenbach, en fait, Monique était vice-présidente de l'association. Ils avaient participé à la construction de l'association entre 2009, 2010 et 2011.

Oui c'est vraiment une initiative qui vient du monde agricole, c'est ça qui est intéressant aussi. Et toi, Jérôme, comment tu arrives dans cette histoire ? Est-ce que tu connaissais Terre de Liens ? Et d'où vient ton envie de porter ce film-là, ce sujet-là en particulier ?
JÉRÔME : Oui, je connaissais Terre de Liens pour l'avoir découvert sur les réseaux, et puis pour connaître la collaboratrice de Marie chez Terre de Liens Alsace, Pauline. Et puis moi depuis 2020 je documente plein de solutions durables, plein de nouvelles manières de voir le monde, des manières plus respectueuses du vivant, globalement. Et en fait, je découvrais en faisant ça énormément de modèles vertueux qui fonctionnent. Où des agriculteurs arrivent à en vivre, où des citoyens sont nourris avec des produits sains, où les terres sont préservées, où la biodiversité est préservée. Mais, je ne me suis jamais posé la question de l'après. C'est un peu grâce à Pauline et Marie que j'ai pris conscience de l'enjeu de la transmission. Parce que ces modèles vertueux, effectivement, on a beau y mettre toute l'énergie du monde, si demain, il n'y a personne qui les porte, qui reprend, même s'il y a des citoyens autour, s'il n'y a pas la paysanne, le paysan ou le couple de paysans qui arrivent à porter le truc, ça va s'effondrer. Un super verger en agroécologie, polyculture, etc., il pourrait disparaître en un claquement de doigts. Et demain, il pourrait y avoir du maïs à sa place, en fait. Donc cette belle vision du monde peut disparaître en un claquement de doigts. Et Pauline m'avait sollicité, parce que Terre de Liens Alsace avait ce projet de documenter la transmission de la ferme de Monique et Francis, sur lequel il y a un historique particulier avec Terre de Liens Alsace. Et en fait, pour la petite histoire, je suis allé sur la ferme pour la première fois, pour enregistrer un podcast d’abord. Je suis revenu de la ferme en étant convaincu qu'il fallait faire plus que des épisodes audio et qu'il y avait une histoire à raconter qui mériterait de se transformer en documentaire.

Et justement, j'allais poser cette question. Pourquoi raconter cette histoire-là en particulier ? Pourquoi raconter l'histoire d'une ferme c'est aussi raconter tout ce que tu viens de dire, Jérôme, sur le monde paysan, sur la question de la transmission qui n'est pas assez présente, etc. Comment s'est fait le choix de mettre un peu la loupe sur cette ferme en particulier ?
MARIE : L'intuition de vouloir raconter l'histoire de la ferme du Runtzenbach, elle est très ancienne. C'est vraiment une ferme où, très vite, on s'est dit : leur parcours, leur histoire, la solidarité qu'il y a autour d'eux, la résilience pour se relever d'un accident [l'accident vasculaire cérébral de Monique]... Il y avait vraiment quelque chose de très fort et de positif qui était intéressant à raconter. Et surtout que la transmission, ce n'était pas une évidence, ce n'est pas quelque chose qui est venu dans un claquement de doigts. Francis, il le dit, c'était un sujet difficile pour lui. Ça fait presque 15 ans que je les connais et je les ai connus à des périodes où le sujet de la transmission était vraiment douloureux et difficile. Et le jour où Francis nous a dit « ça y est, je suis prêt, je veux bien commencer à rencontrer des jeunes, je veux bien m'ouvrir un peu à la suite, à ce qui pourrait arriver », c'est là qu'on se dit « bingo, c'est maintenant qu'il faut qu'on y aille ». Et le choix de cette ferme-là, c'est aussi que c'est une ferme qui est ouverte, qui est ouverte sur le monde. Il y a des activités culturelles, il y a les contes à la ferme, il y a les concerts. Et Francis a cette tradition d'organiser des événements à la ferme et de faire une balade paysagère, une balade autour de la ferme où il avait toujours un discours très fort sur le rôle des paysans, sur la place qu'ils avaient dans le territoire. Et c'est des personnes qui ont une capacité à s'exprimer, c'est ça aussi qui rendait le film possible. C'est qu'ils ont une sensibilité, ils ont une capacité à exprimer leurs émotions, leurs réflexions. Et aussi parce qu'ils avaient une maturité, je veux dire, ils ont réfléchi à cette transmission pendant plus de dix ans, finalement, avant de réellement l'engager. Ça aurait été trop facile d'aller chez quelqu'un pour qui c'est une évidence et pour qui c'est facile, là c'est aussi parce que ça a été un peu une lutte. On a des fois été en lutte aussi avec Francis, à dire mais il faut que tu penses à la suite, il ne faut pas que tu oublies, il ne faut pas que tu te laisses embarquer dans ton quotidien. Et c'est ça qui était intéressant aussi à raconter, de montrer que c'est un vrai défi d'aborder ce sujet. Et ça demande de prendre du temps, de travailler sur soi, de travailler sur comment on accueille aussi de nouvelles personnes qui viennent avec d'autres perceptions. Et c'était le moment, en fait, il y a eu une rencontre avec Jérôme qui est arrivée pile au bon moment. Et oui, au début, on avait des petits moyens, donc on s'est dit on va faire simple, on va faire efficace, on va faire un podcast pour que les agriculteurs puissent même l'écouter dans le tracteur ou dans leur voiture. Il fallait que ce soit accessible facilement. Et je me souviens que Jérôme, il est revenu de son premier tournage en disant mais les filles, mais il faut faire un film, c'est trop beau là-bas. C'est clair que c'est hyper beau.

JÉRÔME : Ce sont aussi des personnages qui sont très forts dans leurs convictions, leur choix de vie le montre. Ils ont bâti une ferme de zéro, c'était une vie de… je ne peux pas dire de sacrifice, mais en tout cas une vie qui a énormément été consacrée à la ferme. Et effectivement, ils ont une aura naturelle, c'est un lieu où il se passe quelque chose, quoi. C'est pas une phrase marketing, c'est vraiment un lieu où il se passe un truc. Et en fait, ce lieu, c'est une sorte de refuge pour plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se passe, la direction que prend le monde aujourd'hui. Et quand tu vas là-bas, en fait, c'est comme une espèce de bulle. Attention, ce n'est pas idéal évidemment, il y a aussi des tracteurs, il y a aussi de l'énergie fossile, etc. Mais malgré tout, dans l'esprit, ça rassemble des gens très différents. De l’ingénieur qui bosse encore dans la chimie en Suisse, mais qui se pose des questions tous les jours et qui a envie de faire mieux pour l'avenir de ses gamins, à des gens qui sont déjà dans l'agriculture, ça rassemble plein de gens qui se retrouvent autour de valeurs communes et d'autres visions du monde, quoi. Et c'est ça que Monique et Francis veulent donner à cette ferme. C'est bien au-delà de l'agriculture, en fait. C'est vraiment une vision du monde qui est partagée sur ce lieu.
Bande annonce du film
Pour moi qui n'ai jamais mis les pieds là-bas, du coup, il y a vraiment, à vous entendre parler avec le film et tout, il y a vraiment une sorte de mystique de ce lieu.
MARIE : Je vais peut-être un peu casser cette idée-là, parce que pour voir, moi, beaucoup de fermes – ça fait 15 ans que je travaille à Terre de Liens, donc je commence à avoir vadrouillé pas mal et à avoir rencontré pas mal de monde. Peut-être que Francis et Monique, ils sont une forme particulière, mais je pense qu'on a une très mauvaise image d'une ferme dans un fonctionnement immuable, où chaque saison se ressemble, où finalement les choses se répètent de jour en jour et on fait toujours la même chose. Et en fait, c'est quand même des lieux extrêmement sociaux. Souvent, c'est quand même des lieux qui sont ouverts, surtout en bio, surtout quand il y a des circuits courts. Et moi, j'ai rencontré beaucoup de paysans qui portaient des discours très forts, qui étaient très observateurs du monde autour d'eux, de leurs clients, de ce que vivaient leurs clients aussi. Et je pense que pour le coup, des fermes comme la leur, il y en a un peu partout, il y a pas mal d'autres lieux. Nous, on avait la chance d'en avoir une, on a pu faire un film, raconter une histoire, mais je pense qu'il ne faut pas chercher trop loin pour trouver d'autres fermes comme ça. Et que c'est un regard aussi qu'on doit nous changer sur les fermes et les investir. Et quand les gens sont prêts à ouvrir la porte, d'y aller, d'aller donner des coups de main, etc. C'est ça qui génère ce terreau, qui permet justement cet accueil, cette ouverture, et qui renforce aussi les paysans et les paysannes dans leur rôle, qui n'est pas juste un rôle de production.
Oui, c'est aussi une histoire qui est transposable à d'autres histoires dans d'autres territoires.... Comment s’est passée la réalisation du film, comment est-ce que Monique et Francis, ont vécu le tournage, et l'idée qu'on puisse vouloir raconter leur histoire ?
JÉRÔME : En tout cas, il y a eu un pari sur le film, ça c'est sûr. Le premier, c'était comment ça allait se passer avec Francis, parce que c'est un personnage qui est entier, clairement. Et surtout, je suis revenu du premier tournage en disant il faut faire un film, mais je suis aussi revenu du premier tournage en disant les filles, vous êtes sûres qu'ils vont transmettre ? Parce que je suis arrivé au moment où on me dit qu'ils sont en train de réfléchir à la transmission, et la première interview que je fais de Francis, il n'a pas l'air du tout prêt, il me disait il n’avait pas de solution. Moi, ça m'a clairement mis le doute : il n'avait pas du tout l'air prêt à transmettre. Mais c'est ça qui est intéressant dans l'histoire, c'est que j'ai quasiment suivi deux ans sur la ferme, donc on voit vraiment la progression aussi de leurs réflexions. Mais ça, je veux dire, au début, on ne peut pas le savoir, comment ça va se passer. Donc il y avait ce premier doute, et le deuxième doute, – et on a vraiment eu de la chance –, c’est que le film, il fallait le rendre à une date précise. Il a été pré-acheté par une chaîne locale qui est Vosges Télé, une chaîne du Grand Est, et du coup, il fallait rendre le film. Dans la bande-annonce, tu vois, à la fin, il y a Maxime [le repreneur de la ferme] qui arrive. Ce Maxime, en fait, il est vraiment arrivé juste pile au bon moment. Parce que sinon, le film, ça restait Monique et Francis qui se posent des questions, et on n'avait pas de perspective sur un avenir possible.
J'allais dire aussi, ce qui a été dur, c'est finalement, à la fin, moi, j'y allais, je n'avais plus envie de sortir la caméra, parce qu'il y a des choses qui s'étaient forcément tissées entre nous. Sur deux ans, je ne sais pas combien de jours j'ai passé sur la ferme, mais c'est énorme. Il y a des jours et des nuits et des dîners, donc en fait, à la fin, la difficulté, c'était presque ça, à la fin, c'était de garder ce rôle de réalisateur et leur rôle d'interviewé.
CHARLOTTE : Mais du coup, c'est hyper intéressant, ça donne presque l'impression d'un film presque expérimental dans le sens où, au jour le jour, c'est vraiment l'humain qui construit le film, la situation qui évolue et tu ne peux pas prévoir, dès le début du film, où est-ce que ça va finir, cette histoire.
JÉRÔME : Complètement, ouais. En fait, le pari qu'on a pris, finalement, c'était de faire un film sur un délai qui est restreint, mais avec un temps de transmission qui est complètement incertain. Je veux dire, parce que si ça se trouve, Maxime aurait pu venir, ou pas, il n'y aurait pas eu de Maxime. Franchement, on a eu de la chance.

MARIE : et nous, l'enjeu, ça a été de continuer à travailler sur la transmission, à faire ce qu'on aurait fait de toute façon qu'il y ait eu un film ou pas, sur le travail de comment créer les conditions pour que demain, il y a quelqu'un qui va se présenter, ça va matcher, parce qu'ils vont être sur la même longueur d'onde, etc. Comment on crée les conditions pour que cette rencontre se passe bien, pour qu'il y ait une relation de confiance qui s'instaure dès le départ, et pour que le processus de transmission puisse s'enclencher. Et donc, notamment, la journée de visite collective qu'on voit dans le film, c'est quelque chose que nous on pratique énormément. On le fait quasi systématiquement sur tous les projets qu'on accompagne. On fait venir les gens tous en même temps. Et aussi pour confronter le cédant à ce qu'il a projeté, à ce qu'il a imaginé. Et pour qu'il y ait un retour pour éventuellement faire évoluer le projet. Et surtout que là, c'est une transmission un peu atypique, parce que c'est à la fois un projet collectif agricole, mais aussi un collectif de vie sur la ferme qui va s'installer. Et donc, il fallait quand même qu'on vérifie, parce que ça, nous, on n'en était pas certaines, que ce cadre un peu inhabituel convenait aux porteurs de projets qu'on accompagnait. Donc, on avait fait venir un petit peu plus largement que ce qu'on aurait fait habituellement. On avait fait un appel assez large. Dans l'idée que c'était une rencontre vraiment entre deux générations pour essayer de voir comment les attentes et les visions des uns et des autres font écho ou se confrontent. Et c'est vrai que nous, on est allées à cette journée, on ne savait pas du tout comment ça allait se dérouler. On avait invité les maires des deux communes à la fin de la journée pour leur faire une restitution. C'était un énorme pari, parce qu'on n'était pas du tout sûres du résultat. On allait voir tout le monde et on nous disait c'est complètement débile votre truc, ça ne peut pas marcher. Mais je pense qu'on avait... Comme dit, on a une antériorité, on se connaît depuis longtemps. Donc il y avait une relation de confiance qui permettait de faire ça. Mais de notre côté, il ne fallait pas que le film prenne le pas sur ce qui se vivait et sur ce qu'on avait besoin de faire avancer et travailler pour que les conditions soient là, pour que le jour où quelqu'un se présente, Maxime ou un autre, l'énergie soit disponible. Souvent, les cédants en fin de carrière, ils sont dans un rythme de travail, ils sont dans un quotidien. C'est des journées à mille à l'heure où il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail à abattre. En fait, on essaie toujours de les faire un peu ralentir en disant que pour que tu puisses accueillir quelqu'un, il faut que tu aies de l'espace, il faut que tu aies de la disponibilité, il faut que ton cerveau soit disponible pour écouter cette personne, pour qu'on puisse y avoir des échanges. C'est une ferme sur laquelle on n'envoyait pas de porteurs de projets pendant plus de dix ans. On nous parlait pourtant de la ferme... On disait non, non, c'est pas le moment, n'y allez pas, c'est pas la peine. Et cette intuition-là de se dire OK, maintenant on peut y aller, on peut ouvrir les portes, ça va bien se passer, ils vont être réceptifs à ce qu'ils vont entendre, aux personnes qui vont être là. Ça, c'était un choix de pari qui a pour le coup bien fonctionné.

Et du coup, ça me permet de rebondir et de revenir un peu à Terre de Liens. C'était quoi le rôle de Terre de Liens dans cette histoire ? Je suppose que ça reboucle avec ce que tu viens de raconter là, mais comment Terre de Liens accompagne ce genre d'histoire ?
MARIE : Je dirais au-delà de Terre de Liens, il y a toujours des réseaux localement qui font ce type d'accompagnement. Donc là, c'est Terre de Liens, mais dans d'autres territoires, ça va plutôt être d'autres associations. Nous, dans notre cas, la transmission, c'est un peu notre cœur de métier. Ça fait partie des sujets qui ont porté la naissance de l'association. Donc on a aussi un historique sur le sujet, on a une expérience.
Quand on accompagne, nous, on part du principe qu'on est sur un territoire où le foncier se vend assez peu. Donc à Terre de Liens Alsace, on accompagne des porteurs de projets, des cédants, des collectivités, des propriétaires institutionnels comme des congrégations de soeurs. Et on essaye que, si à un moment donné, la rencontre se fait, que ça fonctionne, qu'il y a une envie commune de réaliser un projet, à Terre de Liens, on a des outils pour faciliter à la fois cette rencontre et puis surtout à la fin, la possibilité d'acheter la ferme si c'est la bonne solution pour ce projet-là. Notre mode opératoire, notre objectif, il est vraiment de soutenir l'agriculture bio, soutenir l'installation dans une région où ce n'est vraiment pas facile. Donc, on était vraiment dans notre cadre d'intervention, on va dire, assez habituel. On n'a rien fait de particulier parce que c'était le film, on l'a fait parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On est sur un territoire qui est dur et donc le droit à l'erreur, il est faible. On ne peut pas trop se permettre de se planter, on n'a pas beaucoup d'opportunités, pas tant de projets. Donc, il faut qu'on soit attentif à être assez irréprochables dans ce qu'on met en place.
Et justement, où est-ce qu'ils en sont maintenant ? Dans leur transmission ?
MARIE : Eh bien Maxime est venu sur la ferme, puis là il est reparti en estive. Ils se sont revus à différentes occasions. Maxime est venu faire un stage, ensuite un deuxième. Et donc là, il a démarré un stage de parrainage ce printemps avec l'objectif de vivre les quatre saisons sur la ferme puisqu'il était souvent venu en hiver puisque l'été, il était en alpage. Et donc là, le but, c'était qu'il puisse vivre un été avec aussi tous les travaux, de faire les foins etc, voir comment ça se passait. Et dans le courant de l'été, là, il nous a confirmé qu'il était vraiment motivé pour avancer. Il y a encore pas mal de défis à relever parce que c'est pas... C'est pas écrit d'avance. Enfin, économiquement, il y a des choses à caler pour que ça fonctionne. Et la relation, elle est toujours... Elle est toujours belle, en tout cas, entre eux. Et Maxime, il porte vraiment l'envie que ce soit vraiment un collectif qui s'installe. Donc là, on a... Il y a Maxime qui est en train de créer un peu un pilier, une fondation, là, dans le projet pour l'avenir. Et puis, on voit d'autres personnes maintenant qui gravitent. Il y en a qui étaient déjà dans le film et il y en a des nouveaux. Et donc, l'idée, c'est autour du projet d'élevage des brebis, voir comment on va pouvoir organiser d'autres choses, d'autres activités.
JÉRÔME : Maxime traverse plein de doutes, évidemment, parce que c'est beaucoup d'engagement. Mais moi, je trouve ça absolument magique de voir que ça se réalise, en fait. Parce que ça paraissait tellement lointain quand j'ai terminé le film. Mais là, en fait, non, ça se poursuit. Maxime s'installe officiellement le 1er janvier. Francis part à la retraite fin décembre. Donc, l'activité professionnelle va être reprise par Maxime. Et il y a cette volonté de trouver d'autres associés. Et a priori, il y a une bonne entente avec un autre couple. Et donc, voilà, il y a des opportunités qui se créent. Il y a une nouvelle énergie.
Ça fait un an que le film est sorti. Quelle est la réaction du public ? Est-ce que vous avez des retours, notamment, de porteurs de projets paysans qui, du coup, se sentent représentés, à qui ça donne de l'espoir ?

JÉRÔME : Moi, je pourrais plus parler en tant que citoyen, tu vois. Comme je t'ai dit au début, je n'ai pas du tout l'expertise. Donc je me retrouve dans les réactions des gens qui regardent le film. Je ne parle pas des agriculteurs, mais des « simples » citoyens. Ils sont tout aussi horrifiés que moi, je l'étais, de se dire sur cette question de la transmission : "si personne ne reprend, ça va disparaître". Ils se rendent compte des enjeux. Ils se rendent compte de la complexité de la transmission. C'est vrai que ça me permet aussi de revenir sur ta première question qui était, est-ce que c'était dur de faire ce film ? L'autre difficulté, c'est de rendre compréhensible un sujet aussi complexe sur une ferme. Je pense que les réactions, elles sont là. Il y a à la fois de l’effroi, je ne sais pas si c'est le bon mot, de se rendre compte du côté abyssal du défi de la transmission, de toutes les difficultés que doivent porter les paysans, de la difficulté du métier de paysan en général, en France, dans les conditions dans lesquelles on est fait exercer. Et à la fois, cette envie que ça continue. Et bien sûr, les questions des gens, c'est, bah voilà, qu'est-ce qu'ils sont devenus, etc. C'est évidemment la suite. En fait, les gens qui s'attachent à la ferme, ils s'attachent à Monique et Francis et ils ont envie, ils ont envie de voir Maxime qui s'installe, etc. Ils ont envie que ça aille dans ce sens-là. Qu'il y ait un 2, un film 2. On en rigole souvent !
Un film documentaire de 52’ produit par ORAGE Films et WIDE Productions © ORAGE Films 2024 Visa n° 2024003736
Écrit par Jérôme Zindy et Marie Balthazard
Réalisé 100 % en train et à vélo par Jérôme Zindy :)
Faites vivre le film cet automne !
Dans le cadre du festival Alimenterre (du 15 octobre au 20 novembre 2025), vous pouvez assister à ou organiser une projection du film près de chez vous!